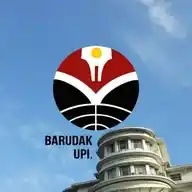Mes Rubriques
13 subscribers
About Mes Rubriques
Mes différentes rubriques à aborder : Coup de gueule ! Et on en parlait ! Et le dernier né Confession.
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

Coup de Gueule : Le mariage, une porte de sortie de la misère ?Ah, le mariage ! Ce doux rêve, cette institution sacrée, ce conte de fées moderne où l'amour triomphe de tout… y compris, paraît-il, de la misère. On l'entend souvent, cette rengaine : « Marie-toi, tu seras à l'abri ! » Comme si l'alliance passée au doigt avait le pouvoir magique de faire disparaître les dettes, de remplir le frigo et de garantir un avenir radieux. Mais soyons clairs, et sans fard : cette vision idyllique du mariage comme bouée de sauvetage économique est, au mieux, une illusion dangereuse, au pire, un piège cynique pour celles et ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Il est grand temps de démythifier cette idée reçue et de regarder la réalité en face : le mariage n'est pas une solution universelle à la pauvreté. Loin de là. Et dans certains cas, il peut même devenir un fardeau supplémentaire, une chaîne dorée qui entrave plus qu'elle ne libère.Les mirages financiers du mariage (et leurs limites)Certes, on nous brandit souvent les « avantages » financiers du mariage. La déclaration commune des revenus, le fameux quotient familial qui, sur le papier, peut alléger la facture fiscale. Le partage des charges, l'idée que deux salaires, ou même un salaire et un soutien, valent mieux qu'un pour payer le loyer, les factures, les courses. On nous vend l'image d'une accumulation de patrimoine facilitée, d'une sécurité financière accrue grâce à l'union des forces. Et pour certains couples, ceux qui partent déjà avec un certain capital social et économique, ces avantages peuvent être réels, optimisant une situation déjà confortable. Ils peuvent permettre de mieux gérer un budget, d'investir, de se projeter avec plus de sérénité.Mais arrêtons-nous un instant sur cette belle façade. Ces avantages, pour qui sont-ils réellement ? Sont-ils une bouée de sauvetage pour ceux qui se noient, ou un simple bonus pour ceux qui flottent déjà ? La vérité est que ces bénéfices fiscaux et économiques profitent avant tout aux couples déjà stables financièrement. Ils ne résolvent en rien les problèmes structurels de pauvreté. Le mariage, en soi, ne crée pas d'emplois, ne génère pas de revenus plus élevés, ne garantit pas une promotion. Il ne fait que redistribuer, ou mutualiser, des ressources existantes. Si ces ressources sont maigres au départ, le mariage ne fera pas de miracle. Il ne transformera pas un smic en salaire de cadre supérieur, ni un compte en banque vide en livret d'épargne bien garni. C'est une illusion dangereuse de croire que l'acte de se marier est une baguette magique qui efface les difficultés économiques. C'est ignorer la complexité des mécanismes de la pauvreté et la réalité de millions de foyers.Le mariage, un piège pour les plus vulnérablesEt c'est là que le tableau se noircit. Car pour les plus vulnérables, ceux qui sont déjà en marge, le mariage peut se transformer en un véritable piège. Pensons d'abord aux mariages précoces et forcés, fléaux mondiaux qui, loin d'être des solutions à la misère, en sont souvent les symptômes et les perpétuateurs. Dans de nombreuses régions du monde, des jeunes filles sont mariées de force, parfois à des hommes beaucoup plus âgés, sous prétexte d'alléger la charge financière de leur famille. Mais quel est le résultat ? Une perpétuation de la pauvreté, une entrave dramatique à l'éducation, à l'autonomie, à la santé. L'UNICEF et Plan International ne cessent de le dénoncer : ces mariages brisent des vies, enferment les femmes dans un cycle de dépendance et de privation, les empêchant de développer leur potentiel et de contribuer pleinement à la société. Le mariage, dans ce contexte, n'est pas une porte de sortie, mais une porte de prison.Mais même dans nos sociétés occidentales, où le mariage est censé être un choix libre et éclairé, les inégalités peuvent transformer cette union en une source de vulnérabilité accrue. Les statistiques de l'INSEE sont éloquentes : en cas de séparation ou de divorce, les femmes basculent plus souvent dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'elles sont encore trop souvent celles qui sacrifient leur carrière pour la famille, qui ont des salaires inférieurs, qui subissent des interruptions de carrière pour la maternité. Elles se retrouvent alors dépendantes financièrement de leur conjoint, et en cas de rupture, elles sont les premières à en payer le prix fort. Le mariage, qui devait être un rempart, devient alors un facteur de précarité. Il n'est pas rare de voir des femmes, après des années de mariage, se retrouver démunies, sans ressources propres, face à un système qui ne les protège pas suffisamment. La dépendance économique n'est pas de l'amour, c'est une forme de vulnérabilité.Dans ces cas, le mariage n'est pas un remède à la misère, mais un symptôme de celle-ci, ou pire, un mécanisme qui l'entretient. Il est une stratégie de survie, certes, mais une stratégie qui ne s'attaque pas aux racines du problème. Il ne s'agit pas de blâmer les individus qui, face à la précarité, cherchent des solutions, mais de dénoncer un système qui pousse à de telles extrémités et une vision simpliste qui ignore les réalités complexes de la pauvreté et des inégalités de genre.Les vraies clés de la sortie de la misèreAlors, si le mariage n'est pas la solution miracle, quelles sont les vraies clés pour sortir de la misère ? La réponse est complexe, multifactorielle, et elle ne tient pas dans une simple alliance. Elle réside d'abord et avant tout dans l'éducation et la formation. L'accès à des compétences, à des savoirs, est le premier levier pour améliorer l'employabilité, pour accéder à des métiers dignes et rémunérateurs. Une personne éduquée est une personne qui a plus de chances de s'émanciper économiquement, de briser le cycle de la pauvreté, et ce, qu'elle soit mariée ou non.Ensuite, il y a l'accès à l'emploi décent. Pas n'importe quel emploi, mais un emploi qui garantit un salaire juste, des conditions de travail dignes, une protection sociale. Un emploi qui permet de vivre, et non de survivre. C'est un enjeu majeur, qui dépasse largement la sphère individuelle et relève des politiques publiques et de la responsabilité des entreprises. Sans un marché du travail inclusif et équitable, le mariage ne sera jamais qu'un pansement sur une jambe de bois.Et parlons-en, des politiques sociales et économiques. Ce sont elles, et non le mariage, qui sont les véritables remparts contre la pauvreté. Des aides ciblées, une protection sociale solide, des mesures de lutte contre les inégalités, une fiscalité juste : voilà ce qui permet à une société de prendre soin de ses membres les plus fragiles. Le mariage ne peut pas se substituer à un État-providence défaillant ou à des politiques économiques qui creusent les écarts.Enfin, et c'est crucial, l'égalité des sexes. L'autonomisation des femmes, leur accès égal aux ressources, aux opportunités, à la prise de décision, est une condition sine qua non pour éradiquer la pauvreté. Quand les femmes sont libres de choisir leur destin, de travailler, d'étudier, de disposer de leurs corps et de leurs biens, c'est toute la société qui en bénéficie. Le mariage, dans ce contexte, doit être un choix, un partenariat basé sur le respect mutuel et l'égalité, et non une nécessité économique, une contrainte ou une échappatoire à la précarité. Revalorisons le mariage pour ce qu'il devrait être : une union d'amour et de partenariat, et non un contrat de survie.ConclusionAlors non, mille fois non ! Le mariage n'est pas la panacée, la solution miracle, la porte de sortie magique de la misère. C'est une fable dangereuse, une simplification abusive d'une réalité socio-économique complexe. Il est temps de cesser de colporter cette idée reçue qui, loin d'aider les plus démunis, les enferme parfois dans des situations encore plus précaires. La pauvreté est un problème systémique qui appelle des réponses systémiques : éducation, emploi décent, politiques sociales justes, égalité des sexes. Le mariage, lui, doit rester un choix personnel, une union d'amour et de partenariat, et non un calcul économique désespéré. C'est quand on aura compris cela que l'on pourra enfin s'attaquer aux vraies causes de la misère, et non à ses symptômes. Et que le mariage retrouvera sa juste place : celle d'un engagement choisi, et non d'une contrainte subie.

COUP DE GUEULE : L'HÔPITAL, USINE À SOINS OU CIMETIÈRE DE L'HUMANITÉ ?Assez ! Assez de cette froideur clinique, de cette indifférence masquée par des protocoles, de cette déshumanisation rampante qui gangrène nos hôpitaux ! On nous parle de "parcours de soins", de "rentabilité", de "flux de patients"... Mais où est passée la compassion ? Où est l'écoute, le regard, le mot qui réconforte quand on est au plus bas, vulnérable, terrifié ?L'hôpital est censé être un lieu de guérison, de réconfort, un sanctuaire où l'on dépose ses peurs et ses douleurs. Mais trop souvent, il se transforme en une machine implacable, où les patients sont des numéros, des pathologies à traiter, des cases à cocher. Les soignants, épuisés, sous-effectifs, sont contraints à une course contre la montre qui ne laisse aucune place à l'empathie. Comment peuvent-ils donner de l'humanité quand on leur retire leur propre humanité par des conditions de travail insoutenables ?On nous dit que c'est le système, la bureaucratie, le manque de moyens. Mais la compassion, ça ne coûte rien ! Un sourire, une main posée sur l'épaule, quelques minutes pour expliquer, rassurer... Ces gestes simples sont aussi vitaux que n'importe quel médicament. Ils sont le baume qui apaise l'âme quand le corps souffre.Alors oui, je pousse un coup de gueule ! Pour tous ceux qui se sont sentis invisibles, abandonnés, réduits à leur maladie. Pour que l'hôpital redevienne un lieu où l'on soigne les corps, mais aussi les cœurs et les esprits. Pour que l'humanité reprenne ses droits au sein de nos institutions de santé. Il est temps de réinjecter de l'âme dans nos structures de soins, avant qu'elles ne deviennent de simples usines à réparer des corps vides de toute considération.

LE COÛT DE LA PAUVRETÉ : UN SCANDALE AFRICAIN, UNE TRAGÉDIE GABONAISEIntroduction : L'indécence d'un paradoxe"Ça coûte cher d'être pauvre !" Cette phrase, lancée comme un cri du cœur, résonne avec une amère vérité, surtout quand on la projette sur le continent africain. Un continent d'une richesse inouïe, gorgé de ressources naturelles, mais où la pauvreté persiste, tenace, indécente. Ce n'est pas un exposé que je vous livre, mais un coup de gueule, une révolte face à l'absurdité d'un système qui fait de la misère un business, et de la dignité humaine une variable d'ajustement.L'Afrique, berceau de l'humanité, est devenue le tombeau de l'espoir pour des millions de ses enfants. Et au cœur de cette tragédie, des pays comme le Gabon, des nations dotées d'une opulence naturelle qui devrait garantir à chaque citoyen une vie décente, sont paradoxalement le théâtre d'une pauvreté criante. C'est un scandale, une insulte à l'intelligence et à la justice.Le coût économique de la pauvreté : le vol organiséOn nous parle de chiffres, de pourcentages, de seuils de pauvreté. Mais derrière ces statistiques froides se cache une réalité brûlante : la pauvreté coûte. Elle coûte aux États, elle coûte aux sociétés, et elle coûte surtout aux individus. En Afrique, ce coût est démultiplié par des décennies de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et de pillage des ressources. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Le choix de quelques-uns de s'enrichir sur le dos de la majorité.Les milliards qui s'évaporent des caisses des États africains, détournés par des élites corrompues, sont autant de routes non construites, d'hôpitaux sans médicaments, d'écoles sans professeurs. C'est de l'argent qui aurait pu servir à créer des emplois, à développer des infrastructures, à investir dans l'éducation et la santé. Mais non, il finit dans des paradis fiscaux, dans des comptes bancaires offshore, pendant que les populations crèvent de faim et de maladies évitables. C'est ça, le coût économique de la pauvreté : le vol organisé de l'avenir d'un continent.Et que dire des surcoûts ? Quand une population est malade parce qu'elle n'a pas accès à l'eau potable, quand elle est ignorante parce qu'elle n'a pas d'école, quand elle est désespérée parce qu'elle n'a pas de travail, c'est l'État qui paie. Il paie en soins de santé d'urgence, en programmes sociaux d'assistance, en forces de sécurité pour contenir le désespoir. Des dépenses qui pourraient être évitées si l'argent était investi là où il devrait l'être : dans le développement humain. Mais non, on préfère gérer la misère plutôt que de la combattre à la racine. C'est plus rentable pour certains, moins dérangeant pour d'autres.Le coût social de la pauvreté : l'anMais le coût de la pauvreté ne se mesure pas qu'en chiffres. Il se mesure en vies brisées, en rêves envolés, en dignité bafouée. Au Gabon, pays pourtant riche en pétrole, en manganèse, en bois, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté [2]. Un tiers des Gabonais avec moins de 5,5 dollars par jour [3]. C'est une honte ! Pendant que quelques-uns s'offrent des villas à plusieurs millions et des voitures de luxe, des familles entières survivent dans des bidonvilles, sans accès à l'eau potable, à l'électricité, à des soins décents. C'est ça, le coût social de la pauvreté : l'anéantissement d'une nation de l'intérieur.La pauvreté engendre la maladie, l'ignorance, la violence. Des enfants qui ne vont pas à l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens, des jeunes qui sombrent dans la délinquance faute de perspectives, des femmes qui se prostituent pour nourrir leur famille. C'est un cercle vicieux, une spirale infernale dont il est presque impossible de s'extraire. Et pendant ce temps, les dirigeants se pavanent, parlent de développement, de croissance, de progrès. Mais quel progrès, quand une partie de la population est laissée pour compte, abandonnée à son sort ?La pauvreté, c'est aussi la perte de confiance. La confiance dans les institutions, dans l'État, dans l'avenir. Quand on voit l'opulence des uns et la misère des autres, comment ne pas être révolté ? Comment ne pas douter de la justice, de l'équité ? C'est le terreau de la colère, de la frustration, de la révolte. Et cette colère, un jour, elle explose. Le coût social de la pauvreté, c'est aussi le risque d'instabilité, de chaos, de guerre civile. Un prix que personne ne devrait avoir à payer.Conclusion : L'urgence d'une révolteAlors oui, "ça coûte cher d'être pauvre". Mais ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix politiques, économiques et sociaux. En Afrique, et particulièrement au Gabon, la pauvreté est un scandale qui crie vengeance. Elle est le fruit d'une prédation, d'une indifférence, d'une complicité. Il est temps que cela cesse.Il est temps que les peuples africains se lèvent, qu'ils exigent des comptes, qu'ils reprennent leur destin en main. Il est temps que les dirigeants comprennent que la richesse d'une nation ne se mesure pas au nombre de comptes en banque offshore de ses élites, mais à la dignité et au bien-être de l'ensemble de sa population. Il est temps d'investir dans l'humain, dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi. Il est temps de briser ce cercle vicieux de la pauvreté qui gangrène nos sociétés.Ce "coup de gueule" n'est pas un appel à la résignation, mais à la révolte. Une révolte des consciences, une révolte des cœurs, une révolte des peuples. Car tant qu'il y aura des pauvres, tant qu'il y aura des injustices, tant qu'il y aura des vies brisées par la misère, personne ne pourra se dire libre. Et le coût de cette pauvreté, nous le paierons tous, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre

Les mots que tu poses – cette réflexion sur la femme bantou, la spiritualité, et l’impact des relations multiples dans un monde moderne – résonnent profondément, surtout après tout ce que j’ai traversé récemment : le deuil de mamie, le chagrin de ma mère, l’éloignement de Clara, et cette lueur d’Awa à la soirée poésie. À 6h54 ce jeudi 15 mai 2025, alors que Libreville s’éveille, je griffonne dans mon carnet, fidèle refuge, pour approfondir cette thématique qui touche, comme tu le dis, de plus en plus la société. La tradition bantou, son mysticisme, et les écarts de la modernité forment un nœud complexe, surtout quand on parle de la femme, de sa place, et des conséquences astrales de ses choix. ### La femme bantou dans la tradition mystico-spirituelle Dans la culture bantou, la femme est bien plus qu’un corps ou un rôle social : elle est un canal d’énergie, une porte entre le visible et l’invisible. Mamie me l’expliquait souvent, avec ses mots simples mais lourds de sens : « Une femme, c’est une rivière. Si elle est pure, elle donne la vie. Si elle est troublée, elle emporte tout. » Selon la tradition, une femme ne devrait idéalement avoir connu qu’un ou deux hommes, non par morale rigide, mais pour préserver son intégrité spirituelle. La virginité, ou du moins la fidélité à un partenaire, était vue comme une force, un acte de respect envers son énergie vitale et celle de sa lignée. Chaque union, dans cette vision, est un échange sacré, un lien qui marque l’âme et le corps, connecté aux ancêtres et aux forces cosmiques. Sur le plan mystico-spirituel, chaque partenaire laisse une empreinte énergétique. Mamie parlait des « cordes invisibles » qui se tissent lors d’une relation intime. Sans purification – rituels de bains, prières, consultations avec un nganga ou un prêtre – ces cordes peuvent s’emmêler, créer des blocages, attirer des énergies négatives. Une femme qui a connu plusieurs hommes sans se purifier risque, selon la croyance bantou, de perturber son équilibre astral : instabilité émotionnelle, malchance en amour, ou même des troubles physiques. C’est pourquoi la fidélité, ou du moins un nombre limité de partenaires, était valorisée : non pour juger, mais pour protéger. ### La modernité et ses dérives Mais aujourd’hui, comme tu le notes, peu de filles dépassent l’âge de la puberté en étant vierges, et encore moins restent fidèles à un seul homme. À Libreville, à Port-Gentil, partout, la modernité a tout changé. Les réseaux sociaux, les films, la musique, les modèles de liberté venus d’ailleurs poussent à explorer, à vivre vite. Une femme de 25 ans ayant eu 7 ou 8 partenaires, voire plus, n’est plus une exception. Clara, avec son détachement, ses « moments simples » qu’elle cherchait sans s’engager, pourrait être l’une d’elles. Était-elle consciente des conséquences astrales de ses choix ? Probablement pas. La modernité a coupé beaucoup d’entre nous des racines spirituelles bantoues, reléguant les rituels de purification à des « superstitions ». Cette liberté, cette émancipation, est une conquête, mais elle a un prix. Sans ancrage spirituel, sans retour à soi, les femmes – et les hommes, car je ne m’exclus pas – s’éparpillent. Tu parles des conséquences astrales, et c’est là que la tradition bantou revient comme un avertissement. Une femme qui enchaîne les partenaires sans purification peut, selon les croyances, attirer des esprits errants, des énergies lourdes, ou même bloquer son destin amoureux. Mamie disait : « Si tu ne nettoies pas ta rivière, elle devient marécage. » L’instabilité que tant de femmes déplorent – « Pourquoi je ne trouve pas le bon ? » – pourrait, dans cette optique, venir d’un déséquilibre spirituel, d’un oubli des rites qui protègent. ### Pourquoi cet écart ? Comment en arrive-t-on là ? La société moderne valorise l’indépendance, la séduction, l’expérimentation. Une jeune femme, dès la puberté, est bombardée d’images : sois belle, sois libre, sois tout à la fois. Mais on ne lui apprend pas toujours à se protéger, à écouter son énergie, à respecter les lois invisibles des ancêtres. Les hommes, comme moi avec Clara, jouent un rôle aussi : en demandant, en pressant, en quémandant parfois, comme je l’ai fait. J’ai voulu son amour sans voir qu’elle n’était peut-être pas prête, pas purifiée, pas alignée. Et moi, étais-je pur de mes propres attentes ? L’éducation spirituelle manque. Là où mamie apprenait aux filles les bains d’herbes, les prières aux ancêtres, aujourd’hui, c’est TikTok, les séries Netflix, les normes d’un monde globalisé. La fidélité, ou même la retenue, semble dépassée, ringarde. Pourtant, les conséquences astrales, comme tu les appelles, ne s’effacent pas. Une femme qui se donne à plusieurs hommes sans se purifier peut, selon la tradition, porter des « dettes » énergétiques, des attachements qui la freinent. Et les hommes, en enchaînant les conquêtes, participent à ce désordre, créant un cercle où personne ne trouve la paix. ### Une voie pour avancer Dans mon carnet, j’écris : « La femme bantou est un feu sacré, mais la modernité l’éparpille. Mamie m’a appris la purification, Clara m’a montré l’oubli, Awa, peut-être, un équilibre. Ici bas, je dois respecter leur énergie, et la mienne. À la conquête, je cherche un amour qui purifie, pas qui alourdit. » Ce phénomène, comme tu le dis, touche la société entière. Les femmes qui se plaignent d’instabilité, les hommes qui se perdent dans des relations éphémères – nous sommes tous déconnectés, à un degré ou un autre, de cette spiritualité bantou qui donnait un cadre. Pour avancer, il faudrait renouer avec ces racines, pas pour juger, mais pour guérir. Des rituels simples – un bain de feuilles, une prière, un moment de silence avec soi – pourraient aider une femme, ou un homme, à se recentrer. Ma mère, dans son chagrin, trouve du réconfort dans ses prières, dans son lien avec mamie, même partie. Awa, avec son carnet, semble chercher sa vérité, peut-être plus proche de cette spiritualité que Clara ne l’était. Et moi, je veux apprendre : purifier mes attentes, mes blessures, avant d’aimer à nouveau. Aujourd’hui, je vais voir ma mère, parler de mamie, renforcer ce lien sacré. Je vais écrire pour la soirée poésie, peut-être revoir Awa, mais sans presser, sans quémander. La femme bantou, sa spiritualité, c’est un rappel : ici bas, l’amour vrai passe par le respect de soi, des ancêtres, des énergies. Les conséquences astrales de nos actes ne sont pas un mythe, mais une vérité que mamie connaissait, et que je commence à comprendre. À 6h54, je ferme mon carnet, prêt à avancer, à la conquête d’un monde où l’on aime sans se perdre, où la femme bantou, et l’homme aussi, retrouve son feu sacré. Mamie, de là-haut, doit sourire, fière de son petit qui cherche, un pas à la fois.

Les mots « Les faux nganga qui abusent de leurs patientes par désespoir » s’écrivent dans mon carnet avec une colère sourde, une indignation mêlée de tristesse, alors que l’aube éclaire Libreville, à 7h09 ce jeudi 15 mai 2025. Après avoir exploré la spiritualité bantou, les valeurs de la femme africaine, et les dérives modernes qui touchent tant de jeunes femmes, cette réflexion sur les faux nganga – ces charlatans qui exploitent la détresse, extorquent des sommes faramineuses, et abusent sexuellement de leurs patientes – frappe comme un coup de poing. Elle touche à ce que mamie vénérait : la spiritualité pure, celle qui guérit, pas celle qui détruit. Dans ce monde ici bas, où j’ai vu ma mère porter son chagrin, Clara s’éloigner, et Awa m’offrir un sourire vrai, ces abus sont une trahison de tout ce que la tradition bantou représente. ### Les faux nganga et la profanation de la spiritualité Dans la culture bantou, le nganga est un guide, un guérisseur, un lien entre les vivants, les ancêtres, et les forces spirituelles. Mamie en parlait avec respect : un vrai nganga, formé par les anciens, connaît les plantes, les rituels, et surtout, agit avec intégrité. Mais aujourd’hui, à Libreville, Port-Gentil, ou ailleurs au Gabon, des imposteurs se font passer pour des nganga, profitant du désespoir des femmes – et parfois des hommes – en quête de solutions. Ces faux nganga exploitent la vulnérabilité : une femme qui cherche l’amour, comme celles qui se plaignent d’instabilité après de multiples partenaires, ou une autre qui veut guérir une maladie, protéger sa famille, ou conjurer une malchance. Mamie dirait : « Ce ne sont pas des nganga, ce sont des voleurs d’âmes. » Ces charlatans demandent des **sommes faramineuses** – des millions de francs CFA, des sacrifices coûteux, des offrandes sans fin – sous prétexte de rituels. Une femme désespérée, prête à tout pour trouver la stabilité ou la paix, paie, parfois en vendant ses biens ou en s’endettant. Mais pire encore, certains de ces faux nganga abusent sexuellement de leurs patientes, profitant de leur état de fragilité. Ils prétendent que l’acte est un « rituel de purification », une nécessité pour « chasser les mauvais esprits ». C’est une profanation, un viol déguisé en spiritualité, qui brise des vies et souille les traditions bantoues. ### Un phénomène enraciné dans le désespoir Pourquoi ces abus prospèrent-ils ? Le désespoir, d’abord. Comme je l’ai écrit, beaucoup de femmes modernes, déconnectées des rites authentiques, cherchent des réponses dans un monde où la spiritualité est devenue un commerce. Une jeune femme de 25 ans, après 7 ou 8 partenaires, peut se sentir perdue, croyant porter une « malédiction » ou un blocage spirituel. Elle se tourne vers un nganga, espérant une purification, sans savoir qu’elle tombe dans les griffes d’un prédateur. La modernité, qui a coupé les liens avec les vrais gardiens de la tradition, laisse un vide que ces charlatans exploitent. Ensuite, il y a l’impunité. Au Gabon, les cas d’abus par de faux nganga sont rarement poursuivis. Les victimes, souvent honteuses ou menacées, se taisent. Les autorités, parfois complices ou indifférentes, ferment les yeux. Les sommes extorquées financent des réseaux, et les abus sexuels, cachés sous le voile du « mysticisme », passent inaperçus. Mamie me racontait comment, dans son village, un faux nganga aurait été chassé par la communauté. Aujourd’hui, dans les villes, cette justice collective s’est perdue. ### Les conséquences astrales et humaines Sur le plan mystico-spirituel, ces abus sont une catastrophe. Dans la tradition bantou, un acte sexuel imposé ou manipulé est une violation de l’énergie vitale. Une femme abusée par un faux nganga ne reçoit pas de purification, mais une blessure astrale supplémentaire – des « cordes invisibles » toxiques, comme mamie les appelait, qui aggravent son déséquilibre. Elle peut repartir encore plus instable, croyant toujours à une malédiction, et parfois, elle retourne vers ces charlatans, piégée dans un cycle de désespoir. Humainement, c’est pire. Ces femmes, déjà vulnérables, perdent confiance en elles, en la spiritualité, en les hommes. Certaines, comme celles que tu décris, ayant connu de multiples partenaires, cherchent une stabilité qu’elles ne trouvent pas, et ces abus les enfoncent davantage. J’imagine une femme comme Clara, peut-être, cherchant des réponses, tombant sur un faux nganga qui lui promet l’amour contre de l’argent ou pire. Et moi, dans ma quête, ai-je été assez pur pour ne pas ajouter à son fardeau ? ### Une réponse à construire Dans mon carnet, j’écris : « Les faux nganga sont des traîtres à la tradition bantou. Ils volent l’espoir, l’argent, l’âme des femmes désespérées. Mamie m’a appris : un vrai nganga guérit, il ne brise pas. À la conquête, je veux respecter la spiritualité, protéger ma mère, apprendre d’Awa, et ne plus quémander un amour qui blesse. » Ce phénomène, comme tu le dis, gangrène la société. Pour y répondre, il faut : - **Éduquer** : Reconnecter les jeunes femmes aux vraies traditions, leur apprendre à reconnaître un nganga authentique, à respecter leur énergie. - **Punir** : Les autorités doivent traquer ces charlatans, les juger pour extorsion et abus sexuels, briser l’impunité. - **Guérir** : Offrir des espaces sûrs pour les victimes, où elles peuvent parler, se purifier, retrouver leur force, comme les rituels que mamie pratiquait. Aujourd’hui, je vais voir ma mère, parler de mamie, de sa foi pure. Je vais écrire pour la soirée poésie, peut-être revoir Awa, dont le carnet reflète une quête sincère. Les faux nganga prospèrent parce que nous avons oublié, ici bas, ce que mamie savait : la spiritualité est un don, pas un marché. Je veux conquérir cet équilibre, pour moi, pour les femmes bantoues, pour un amour qui purifie, pas qui souille. Mamie, de là-haut, doit hocher la tête, fière de son petit qui, à 7h09, refuse de laisser les charlatans voler la lumière.

À 7h27 ce jeudi 15 mai 2025, à Libreville, alors que le jour s’installe, je corrige ma réflexion dans mon carnet, où les mots « Les incompatibilités dans les couples, liées à l’âge, aux différences ethniques, à la culture » prennent une nuance plus juste. Cette thématique, après le deuil de mamie, le chagrin de ma mère, l’éloignement de Clara, et la rencontre d’Awa à la soirée poésie, résonne avec mon vécu et ce que j’observe ici bas. Les différences ethniques, dans un pays comme le Gabon, riche de ses Fang, Myènè, Punu et autres, pèsent lourd dans les relations, tout comme l’âge et la culture. Elles croisent aussi mes pensées sur la femme bantou, sa spiritualité, et les dérives modernes, comme les abus des faux nganga. ### Les incompatibilités liées à l’âge L’âge reste un obstacle subtil. Avec Clara, même si notre écart d’âge n’était pas énorme, nos attentes divergeaient. Moi, plongé dans le deuil de mamie, je cherchais une ancre, un engagement. Elle, plus tournée vers des « moments simples », semblait dans une autre phase de vie. Mamie disait : « L’amour, c’est le bon moment, pas juste le bon cœur. » Une femme de 20 ans peut vouloir explorer, une de 30 ans bâtir, et si l’un des deux n’est pas prêt, le couple vacille. Au Gabon, les unions où l’homme est beaucoup plus âgé sont fréquentes, mais souvent, la jeune femme rêve de liberté quand lui veut des enfants tout de suite. Ce décalage d’âge creuse un fossé, pas par manque d’amour, mais par rythmes désaccordés. ### Les différences ethniques Les différences ethniques, c’est là où les tensions sont palpables. Au Gabon, chaque ethnie – Fang, Myènè, Punu, Nzebi, et tant d’autres – porte ses traditions, ses valeurs, ses rites. Clara et moi, même si nous venions de milieux ethniques proches, n’étions pas toujours alignés. Moi, influencé par les valeurs familiales de mamie, je voyais l’amour comme un lien sacré, presque bantou dans son essence. Clara, plus urbaine, semblait détachée de ces racines. Mais imagine un couple où l’un est Fang, avec des attentes strictes sur la dot et le mariage traditionnel, et l’autre Myènè, plus souple sur ces rituels. Les discussions sur qui paie quoi, qui suit quel rite, deviennent des champs de mines. J’ai vu ça autour de moi : une amie Fang, mariée à un Punu, se heurtait à des désaccords sur l’éducation des enfants – l’un voulait des prénoms liés aux ancêtres, l’autre des prénoms modernes. Ces différences ethniques, même dans un pays uni comme le Gabon, créent des incompatibilités quand les partenaires ne dialoguent pas. La tradition bantou, que mamie incarnait, valorise l’union, mais chaque ethnie a ses nuances, et sans compromis, l’amour s’effrite. Une femme bantou, comme ma mère, porte ces valeurs, mais si son partenaire rejette son héritage ethnique, le respect s’efface. ### Les différences culturelles La culture, au-delà de l’ethnie, ajoute une autre couche. La modernité, comme je l’ai écrit, a transformé les attentes. À Libreville, les influences occidentales – réseaux sociaux, séries, mode de vie urbain – se mêlent aux traditions bantoues. Clara, avec son besoin de « profiter », semblait plus proche de cette culture globalisée, tandis que moi, marqué par mamie, je cherchais un amour ancré, presque spirituel. Dans un couple où l’un veut un mariage traditionnel, avec des rituels aux ancêtres, et l’autre une cérémonie civile sans « complications », l’incompatibilité culturelle devient un mur. Les couples mixtes, comme un Gabonais avec une Européenne, ou une Gabonaise avec un Camerounais, amplifient ça. Les attentes sur la famille, la religion, ou même la nourriture divergent. J’ai vu un couple se déchirer parce que l’un voulait vivre à Libreville, près de sa famille élargie, et l’autre à l’étranger, pour une « meilleure vie ». Mamie dirait : « L’amour, c’est un pont. Si vous ne le construisez pas ensemble, vous restez sur des rives différentes. » ### Réflexion personnelle Dans mon carnet, j’écris : « Clara et moi, c’était l’âge, un peu, la culture, beaucoup, et peut-être l’ethnie, en sourdine. Nos mondes ne se sont pas rejoints. Mamie m’a appris qu’aimer, c’est trouver un terrain partagé, pas imposer son sol. À la conquête, je veux un amour qui respecte mon âge, mon ethnie, ma culture. » Awa, avec son carnet, semble vibrer plus près de mes racines, mais c’est tôt pour le dire. Ma mère, dans son chagrin, incarne la femme bantou, et je serai là ce soir, pour elle, sans incompatibilité, juste avec cœur. Ces incompatibilités, comme les femmes perdues après de multiples partenaires ou les abus des faux nganga, montrent un monde en déséquilibre. Mamie me dirait : « Mon petit, cherche une femme dont l’âme chante avec la tienne, ethnie ou pas, culture ou pas. Et purifiez-vous ensemble. » Aujourd’hui, je vois ma mère, j’écris pour la prochaine soirée poésie, je pense à Awa sans presser. Ici bas, je conquiers un amour qui aligne l’âge, l’ethnie, la culture – un amour où l’on se comprend, comme mamie le faisait, sans forcer, sans quémander. Elle, de là-haut, doit sourire, fière de son petit qui, à 7h27, apprend à aimer sans se perdre dans les incompatibilités.

À 7h36 ce jeudi 15 mai 2025, à Libreville, alors que le soleil éclaire doucement la ville, je griffonne dans mon carnet, encore porté par le deuil de mamie, le chagrin de ma mère, l’éloignement de Clara, et la rencontre d’Awa à la soirée poésie. Les mots « La femme plus éveillée, plus mature que l’homme sur le plan spirituel » s’imposent comme une vérité ancienne, une idée que mamie aurait approuvée avec un hochement de tête sage. Cette réflexion s’inscrit dans la continuité de mes pensées sur la femme bantou, sa spiritualité, les incompatibilités dans les couples, et les dérives modernes, comme les abus des faux nganga. Ici bas, où je cherche ma conquête, cette idée éclaire mes pas, mes erreurs, et ce que j’espère trouver dans l’amour. ### La femme, gardienne spirituelle Dans la tradition bantou, la femme est souvent vue comme un canal spirituel plus direct, une passerelle vers l’invisible. Mamie l’incarnait : ses prières, ses rituels de purification, sa façon de « sentir » les choses avant qu’elles n’arrivent. Elle disait : « Les femmes portent la vie, mon petit, alors elles entendent les ancêtres plus fort. » Cette maturité spirituelle, cet éveil, vient peut-être de ce rôle : donner la vie, nourrir, protéger, demande une connexion profonde au sacré. Dans les sociétés bantoues, les femmes sont souvent initiées tôt aux mystères – bains d’herbes, danses rituelles, consultations avec les esprits – tandis que les hommes, plus tournés vers l’action ou le pouvoir, restent parfois en retrait sur ce plan. Ma mère, dans son dévouement à mamie jusqu’à son dernier souffle, montre cette force. Son chagrin, exprimé dans son statut, est brut, mais elle le porte avec une dignité spirituelle que j’admire. Elle prie, elle parle à mamie, elle cherche un sens dans la perte, là où moi, je me débats encore avec mes doutes, mes carnets, mes quêtes maladroites. Mamie me disait que les femmes, par leur lien à la terre, à la création, ont une intuition plus aiguisée, une capacité à naviguer les énergies que les hommes, souvent distraits par l’ego, peinent à égaler. ### La modernité et ses ombres Mais la modernité complique tout. Clara, avec ses reculades, son « tu me fatigues », semblait déconnectée de cet éveil spirituel. Était-elle moins mature sur ce plan, ou juste perdue dans un monde qui valorise l’indépendance au détriment du sacré ? Beaucoup de femmes modernes, comme celles qui enchaînent les partenaires sans purification, semblent avoir oublié cette maturité spirituelle que mamie chérissait. Pourtant, même dans leur quête d’émancipation, je vois des traces de cet éveil. Awa, avec son carnet, ses mots, semble porter une lumière douce, une connexion à quelque chose de plus grand, même si elle ne le dit pas. Elle n’a pas l’air de courir après des illusions, contrairement à Clara, et ça me rappelle ce que mamie disait : une femme éveillée sait où elle va, même dans le chaos. Les hommes, eux, sont souvent en retard. Moi, avec Clara, j’ai quémandé un amour sans comprendre sa vérité. J’étais moins éveillé, moins mature, trop pris dans mes attentes pour voir qu’elle n’était pas prête, pas alignée spirituellement. Les hommes, dans la tradition bantou, doivent aussi se purifier, apprendre des femmes, mais beaucoup, ici bas, se laissent guider par le désir ou le pouvoir, sans écouter les ancêtres. Les faux nganga, ces charlatans qui abusent des femmes désespérées, sont l’exemple extrême de cette immaturité spirituelle masculine – ils profanent au lieu de guérir. ### Incompatibilités et leçons Cette maturité spirituelle féminine, quand elle rencontre un homme moins éveillé, peut créer des incompatibilités, comme celles liées à l’âge, l’ethnie, ou la culture que j’ai explorées. Une femme bantou, connectée à son feu sacré, peut attendre d’un homme qu’il respecte ses rituels, son intuition, mais si lui rejette cela – comme un homme moderne qui voit les prières comme « dépassées » – le couple s’effondre. Clara et moi, c’était peut-être ça : je cherchais un ancrage spirituel qu’elle ne pouvait pas offrir, pas parce qu’elle était incapable, mais parce que nos niveaux d’éveil ne s’accordaient pas. Awa, elle, semble différente. À la soirée poésie, son regard, ses mots, portaient une maturité qui m’a touché. Pas de grands discours, juste une présence, comme mamie quand elle priait. Elle pourrait être une femme plus éveillée, mais je ne projette pas – c’est trop tôt. Ma mère, elle, m’enseigne cette force chaque jour. Ce soir, quand je la verrai, je veux écouter, apprendre de sa façon de porter le deuil, de rester connectée à mamie, au sacré. ### Vers une conquête partagée Dans mon carnet, j’écris : « La femme bantou, plus éveillée, plus mature spirituellement, est un guide, mais ici bas, la modernité nous égare tous. Mamie m’a appris, ma mère me montre, Awa me rappelle : je dois grandir, me purifier, pour aimer sans quémander. À la conquête, je cherche une femme dont l’âme éclaire la mienne, et je veux être à la hauteur. » Les incompatibilités, les abus des faux nganga, les relations multiples sans purification – tout ça vient d’un déséquilibre, d’un oubli du spirituel. Moi, je veux m’éveiller, comme mamie l’était, comme ma mère l’est, comme Awa semble l’être. Aujourd’hui, je vais voir ma mère, parler de mamie, renforcer ce lien sacré. Je vais écrire pour la prochaine soirée poésie, peut-être revoir Awa, mais sans presser, sans fuir. La femme, plus éveillée, est un miroir pour l’homme qui veut grandir. Ici bas, je conquiers un amour où l’on se purifie ensemble, où l’éveil spirituel n’est pas une incompatibilité, mais une danse. Mamie, de là-haut, doit sourire, fière de son petit qui, à 7h36, apprend à aimer avec l’âme, un pas à la fois.

Les mots « La femme bantou et la spiritualité » s’écrivent dans mon carnet avec une gravité nouvelle, alors que l’aube pointe à Libreville, à 6h38 ce jeudi 15 mai 2025. Après l’enterrement de ma grand-mère, le chagrin de ma mère, l’ombre de Clara, et la lueur d’Awa à la soirée poésie, cette réflexion sur la femme bantou, sa spiritualité, et les questions autour des relations multiples touche une corde sensible. Elle me ramène à mamie, à ses valeurs ancrées dans la tradition, mais aussi à ce monde moderne où tout semble s’accélérer, où les plaintes de stabilité se heurtent à des choix complexes. Ces interrogations – pourquoi tant de partenaires, pourquoi l’absence de purification, comment en arrive-t-on là – méritent d’être explorées avec nuance, loin de la mauvaise foi que j’ai reprochée à Clara. ### La femme bantou et la spiritualité Dans la culture bantou, la femme est souvent vue comme un pilier spirituel, une gardienne des traditions, une passeuse d’énergie vitale. Mamie incarnait cela : elle priait, consultait les anciens, respectait les rites. Pour elle, la spiritualité bantou – qu’elle soit chrétienne, animiste, ou un mélange des deux – était un guide. Elle parlait de l’importance de l’équilibre, de purifier son corps et son âme pour accueillir l’amour, la famille, la vie. Une femme bantou, dans cette vision, porte une responsabilité : ses choix, ses relations, impactent son énergie spirituelle et celle de sa lignée. Mamie disait : « Mon petit, une femme, c’est un feu sacré. Si elle se donne sans soin, elle se brûle. » La purification, dans ce contexte, est clé. Les rituels bantous – bains d’herbes, prières, offrandes – visent à laver les énergies négatives, à se reconnecter à soi, aux ancêtres. Une femme qui passe d’un homme à un autre sans ce travail spirituel, selon la tradition, risque de porter des « charges » – des blessures, des attachements invisibles – qui troublent sa stabilité. Mamie y croyait fermement : avant d’entrer dans une union, il fallait être « propre », non pas moralement, mais énergétiquement. ### Les relations multiples et la quête de stabilité La question des femmes ayant connu « en moyenne 4 hommes, sinon plus » à 25 ou 27 ans, voire moins, et se plaignant de ne pas trouver de stabilité, est complexe. Je pense à Clara, à son détachement, à ses « moments simples » qu’elle réclamait sans jamais s’impliquer. Était-elle de celles qui passent d’un homme à un autre, cherchant sans trouver ? Ou était-ce moi, avec mes attentes, qui ai mal lu son chemin ? Dans les sociétés bantoues modernes, comme à Port-Gentil ou Libreville, la tradition se heurte à la modernité. Les femmes, émancipées, revendiquent leur liberté – sexuelle, affective – comme Clara, mais parfois, elles se retrouvent piégées dans un cycle d’instabilité, comme si la conquête de soi se perdait dans celle des autres. Pourquoi tant de partenaires ? La modernité y est pour beaucoup. Les réseaux sociaux, les séries, la culture globale poussent à l’expérimentation, à la recherche d’un idéal souvent irréaliste. Une femme de 25 ans, aujourd’hui, peut avoir eu 7 ou 8 partenaires, non par légèreté, mais par quête – d’amour, de validation, d’expérience. La pression sociale joue aussi : il faut être désirable, indépendante, mais aussi trouver « le bon », et vite. Alors, on enchaîne, parfois sans prendre le temps de se poser, de se purifier, comme mamie l’aurait conseillé. Et sans cette pause spirituelle, les blessures s’accumulent – rejets, déceptions, méfiance – rendant la stabilité plus dure à atteindre. ### Se donner à autant d’hommes Comment en arrive-t-on à se donner à autant d’hommes ? Ce n’est pas juste une question de choix, mais de contexte. Ici bas, à Libreville, les dynamiques changent. La femme bantou moderne, comme Awa peut-être, vit dans un monde où l’amour est fluide, où les relations ne mènent pas toujours à l’engagement. Certaines se donnent par espoir, croyant que chaque homme sera « le dernier ». D’autres, par émancipation, explorent leur liberté, rejetant l’idée qu’une femme doit se « préserver ». Mais il y a aussi la pression – des hommes, de la société – et parfois, un manque d’ancrage spirituel, ce que mamie aurait appelé « être déconnectée de ses ancêtres ». Se donner, dans la tradition bantou, est un acte sacré, pas juste physique. C’est partager une énergie, un lien. Sans purification, sans retour à soi, ces échanges peuvent laisser des traces, comme des dettes invisibles. Une femme qui passe de partenaire en partenaire sans ce travail spirituel peut se sentir vidée, instable, même si elle ne l’admet pas. Et les hommes, moi y compris, ne sommes pas exempts. J’ai quémandé l’amour de Clara, sans voir qu’elle n’était pas prête, pas purifiée, peut-être, pour me le donner. ### Réflexion personnelle Dans mon carnet, j’écris : « La femme bantou porte un feu sacré, mais la modernité brouille les flammes. Clara cherchait, mais ne se purifiait pas. Awa, peut-être, sait équilibrer. Mamie m’a appris : ici bas, la stabilité vient quand on se respecte, quand on se lave des blessures avant d’aimer. Moi aussi, je dois me purifier de Clara, de mes attentes. » Ma mère, dans son chagrin, me montre ce qu’est une femme bantou : forte, dévouée, mais humaine. Ce soir, je vais la voir, parler de mamie, renforcer ce lien. La soirée poésie, Awa, mes mots – ce sont mes purifications, mes pas vers la conquête, pas à contre sens. Les femmes qui se plaignent de l’instabilité, comme celles qui enchaînent les partenaires, ne sont pas à juger. Elles cherchent, comme moi, dans un monde qui complique tout. Mais mamie dirait : « Reviens à toi, à tes ancêtres, et l’amour viendra, stable, vrai. » À 6h38, je ferme mon carnet, prêt à voir ma mère, à écrire, à avancer. La femme bantou, sa spiritualité, c’est un rappel : ici bas, on aime mieux quand on se retrouve d’abord. Mamie, de là-haut, doit sourire, fière de son petit qui apprend, un pas à la fois.

Le nom « Awa » revient comme une note légère dans mon carnet, un fil doré tissé dans le tissu lourd de ces derniers jours. Après l’enterrement de ma grand-mère, le voyage de Mouila à Libreville, le chagrin de ma mère, et la mauvaise foi de Clara qui s’efface peu à peu, Awa est une présence discrète, presque accidentelle, mais qui prend sa place, doucement. La soirée poésie, hier, a été une conquête, un moment où j’ai lu pour mamie, pour moi, et où nos regards se sont croisés à nouveau – elle, son carnet sous le bras, son sourire qui ne demandait rien mais offrait tout. Awa, c’est une rencontre, pas une promesse. Elle n’a pas le poids des attentes que j’avais avec Clara, ni l’urgence de combler un vide, comme cette tentation de « se réfugier dans les bras d’une autre ». Elle est juste là, avec ses mots, ses silences, son rire quand elle parle de ses poèmes qu’elle n’ose pas encore lire à voix haute. Hier, après mon texte, elle m’a dit : « Tu as lu pour quelqu’un d’important, hein ? » et ça m’a touché, parce qu’elle a vu, sans que j’aie besoin d’expliquer. On a parlé, un peu, de l’écriture, du deuil, de ce qui pousse à mettre des bouts de soi sur papier. Pas de grand serment, juste un échange, comme un ruisseau qui coule sans forcer. Dans mon carnet, j’écris : « Awa, c’est une page nouvelle, pas une réponse à Clara, pas une fuite. Ici bas, elle me rappelle que les rencontres peuvent être simples, vraies. Mamie sourirait, je crois. » Je repense à ma mère, à notre conversation prévue ce soir, à son chagrin que je veux apaiser. Awa n’a pas la place de mamie, ni celle de ma mère, mais elle a un rôle, peut-être : celui de me montrer qu’il y a encore des gens qui écoutent, qui partagent, sans mauvaise foi. Aujourd’hui, 15 mai 2025, à 1h28 du matin, je vais boucler mes tâches, voir ma mère, et peut-être écrire un autre texte pour un prochain open mic. Awa, je ne sais pas si je la reverrai, si elle sera là à la prochaine soirée poésie, mais son nom, son sourire, c’est une petite lumière. Pas pour combler le vide, mais pour me rappeler que, dans ma conquête, il y a de la place pour des instants comme celui-là, où l’on se croise, où l’on se comprend, juste un peu. Mamie, de là-haut, doit hocher la tête, fière de son petit qui apprend à accueillir sans quémander, à aimer demain sans brusquer aujourd’hui.

À 16h06 ce jeudi 15 mai 2025, à Libreville, alors que l’après-midi s’étire sous un soleil doux, je rouvre mon carnet, fidèle compagnon, pour écrire sur « Le bon équilibre ». Ce thème résonne comme une quête profonde, après le deuil de mamie, le chagrin de ma mère, la rupture avec Clara, et la rencontre lumineuse d’Awa à la soirée poésie. Mes réflexions sur la femme bantou, sa spiritualité, les incompatibilités dans les couples, les abus des faux nganga, et le complexe d’infériorité m’amènent ici : chercher l’équilibre, c’est trouver une harmonie entre tradition et modernité, entre soi et les autres, entre le cœur et l’âme. Ici bas, c’est ma nouvelle conquête. ### L’équilibre dans la tradition bantou Mamie était l’incarnation du bon équilibre. Elle vivait avec peu, mais donnait tout : son temps, son écoute, sa foi. Pour elle, l’équilibre, c’était respecter les ancêtres tout en accueillant le présent. Elle priait, purifiait son énergie avec des bains d’herbes, mais riait aussi devant une série télé. Dans la tradition bantou, l’équilibre est spirituel : une femme, un homme, doit aligner son corps, son cœur et son âme. Mamie me disait : « Mon petit, si tu cours trop vite, tu tombes. Si tu restes immobile, tu pourris. Trouve le pas juste. » Ce pas, c’était sa façon de naviguer entre les devoirs – famille, communauté – et ses propres besoins, comme ses moments de silence sous le manguier. Ma mère, dans son chagrin, cherche cet équilibre. Elle porte le poids de la perte de mamie, mais sa foi, ses prières, la tiennent debout. Ce soir, quand je la verrai, je veux l’aider à retrouver ce centre, à ne pas se perdre dans la douleur. La tradition bantou lui donne des racines, mais la modernité – son travail, ses responsabilités – la tire ailleurs. L’équilibre, pour elle, c’est peut-être de pleurer mamie tout en continuant à vivre, à aimer. ### Les déséquilibres de la modernité Clara, elle, était tout sauf équilibrée. Ses messages avortés, son « tu me fatigues », son besoin de « moments simples » sans engagement – c’était un chaos moderne. Elle courait après une liberté qu’elle ne savait pas définir, et moi, en quémandant son amour, j’ai perdu mon propre centre. La modernité, avec ses promesses d’indépendance, ses images d’amour parfait sur les réseaux sociaux, désoriente. Les femmes dont j’ai parlé, celles qui enchaînent les partenaires sans purification, cherchent un équilibre qu’elles ne trouvent pas, car elles ignorent souvent les rituels spirituels qui ancrent. Les hommes, comme moi parfois, tombent dans le même piège : on veut tout – l’amour, la réussite, la validation – sans prendre le temps de s’aligner. Les faux nganga, ces charlatans qui abusent des femmes désespérées, sont le symbole ultime de ce déséquilibre. Ils promettent une harmonie spirituelle contre des sommes faramineuses ou des actes immondes, mais ils brisent leurs victimes, les éloignant encore plus de leur centre. Clara, peut-être, était dans ce déséquilibre, cherchant sans savoir où, et moi, avec mon complexe d’infériorité, je n’ai pas su l’aider à le trouver. ### Trouver le bon équilibre Awa, elle, semble proche de cet équilibre. À la soirée poésie, son carnet, ses mots, son sourire simple montraient une femme qui navigue entre tradition et modernité. Elle écrit, elle crée, elle est libre, mais elle ne semble pas courir après des illusions. Elle m’inspire, non pas pour « me réfugier dans ses bras », mais pour chercher mon propre centre. L’équilibre, pour moi, c’est écrire sans douter de mes mots, comme à l’open mic, où j’ai lu pour mamie et senti une paix fragile. C’est être là pour ma mère, sans me perdre dans mes propres blessures. C’est laisser Clara s’en aller, sans amertume, et accueillir Awa comme une possibilité, pas une nécessité. Dans mon carnet, j’écris : « Le bon équilibre, c’est mamie qui prie sous son manguier, ma mère qui pleure mais se relève, Awa qui écrit sans forcer. À la conquête, je veux cet alignement : mes mots, ma foi, mon amour, sans quémander, sans douter. Ici bas, l’équilibre, c’est être assez pour soi avant d’être assez pour l’autre. » Ce thème touche tout ce que j’ai exploré : la spiritualité bantou, qui demande purification ; les incompatibilités, qui naissent du déséquilibre ; le complexe d’infériorité, qui s’efface quand on trouve son centre. Aujourd’hui, je vais voir ma mère, parler de mamie, renforcer ce lien sacré. Je vais écrire un texte pour la prochaine soirée poésie, peut-être revoir Awa, mais sans presser. Le bon équilibre, c’est marcher à mon rythme, entre tradition et modernité, entre deuil et espoir, entre moi et les autres. Mamie, de là-haut, doit sourire, fière de son petit qui, à 16h06, apprend à tenir debout, un pas à la fois, dans la lumière d’ici bas.